Les
ascensions en cerf-volant ( 1909 – 1917 )
La guerre
 En
août 1914, deux sections de cerf-volant sont envoyées
au front. Celle de la 23e compagnie d’aérostiers
de Belfort et celle d’Epinal, la 30e, conduite par Saconney.
Les ascensions en cerf-volant sont encore nombreuses, ainsi,
du 27/9/14 au 10/2/15, 124 heures d’observation sont faites
en ballon, mais également 48 en cerf-volant. Ces ascensions
sont faites pour régler les tirs des canons français
sur les batteries ennemies. Saconney monte lui-même dans
la nacelle et « ne cesse de faire de la propagande ».
Le nombre de compagnies est augmenté, mais peu à
peu l’apparition des ballons cerf-volant de Caquot qui
résistent au vent élimine les ballons sphériques
et provoque l’arrêt presque complet de l’usage
des cerfs-volants au printemps 1916. Ainsi, la 46e compagnie,
celle de Pantenier, n’ascensionne qu’une fois en
cerf-volant entre septembre 1915 et novembre 1916. En
août 1914, deux sections de cerf-volant sont envoyées
au front. Celle de la 23e compagnie d’aérostiers
de Belfort et celle d’Epinal, la 30e, conduite par Saconney.
Les ascensions en cerf-volant sont encore nombreuses, ainsi,
du 27/9/14 au 10/2/15, 124 heures d’observation sont faites
en ballon, mais également 48 en cerf-volant. Ces ascensions
sont faites pour régler les tirs des canons français
sur les batteries ennemies. Saconney monte lui-même dans
la nacelle et « ne cesse de faire de la propagande ».
Le nombre de compagnies est augmenté, mais peu à
peu l’apparition des ballons cerf-volant de Caquot qui
résistent au vent élimine les ballons sphériques
et provoque l’arrêt presque complet de l’usage
des cerfs-volants au printemps 1916. Ainsi, la 46e compagnie,
celle de Pantenier, n’ascensionne qu’une fois en
cerf-volant entre septembre 1915 et novembre 1916.
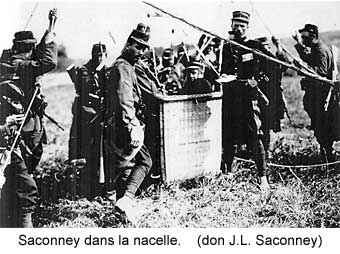 Toujours
selon Pantenier, il en était à peu près
de même dans les 11 autres sections de cerf-volant.
Cependant, les cerfs-volants ne sont pas complètement
retirés des compagnies. Dans un courrier du 12 avril
1917, un ministre de la guerre, le lieutenant colonel Richard,
évoque « 12 compagnies d’aérostiers
aux armées (qui) possèdent un matériel
de cerf-volant parfaitement au point ». Cependant, leur
inactivité exaspère les cerfs-volistes (particulièrement
Frantzen et Pantenier) qui pensent que leurs propres cerfs-volants,
mieux conçus que le Saconney, pourraient provoquer
un regain de l’usage des cerfs-volants. Ils estiment
que la marine particulièrement gagnerait à les
employer pour le repérage des sous-marins qui devient
vital en 1917. Toujours
selon Pantenier, il en était à peu près
de même dans les 11 autres sections de cerf-volant.
Cependant, les cerfs-volants ne sont pas complètement
retirés des compagnies. Dans un courrier du 12 avril
1917, un ministre de la guerre, le lieutenant colonel Richard,
évoque « 12 compagnies d’aérostiers
aux armées (qui) possèdent un matériel
de cerf-volant parfaitement au point ». Cependant, leur
inactivité exaspère les cerfs-volistes (particulièrement
Frantzen et Pantenier) qui pensent que leurs propres cerfs-volants,
mieux conçus que le Saconney, pourraient provoquer
un regain de l’usage des cerfs-volants. Ils estiment
que la marine particulièrement gagnerait à les
employer pour le repérage des sous-marins qui devient
vital en 1917.
Ces cerfs-volistes innovateurs trouvent des
appuis politiques, mais l’institution militaire défend
le cerf-volant réglementaire Saconney et pas toujours
de façon rationnelle et équitable. Ainsi, dans
un courrier de fin 1917, le lieutenant colonel Richard indique
« Aucune expérience comparative entre divers
types de cerfs-volants n’a été faite à
proprement parler » et quelques lignes plus loin : »Il
semble bien qu’aucun (amateur) n’ait réussi
à créer un type de cerf-volant susceptible de
soutenir la comparaison avec le type réglementaire
».Comment a-t-on pu comparer sans faire d’expérience
comparative ? Saconney lui-même est hors de cause dans
la querelle, en 1917 les cerfs-volants ne faisaient plus partie
de ses soucis, mais comme lors des comparaisons avec le modèle
Madiot, il apparaît que le cerf-volant Saconney a bénéficié
d’une bienveillance particulière.
En janvier 1918, la marine accepte que Frantzen
prouve son savoir-faire. La faiblesse des moyens fournis et
le manque de rigueur du cerfvoliste conduisent ces essais
à l’échec.
En somme, le cerf-volant observatoire a été
très peu utilisé pendant la guerre, en France
comme chez les autres belligérants. Les progrès
de l’aérostation et de l’aviation permettent
à ces derniers d’occuper le ciel par presque
tous les temps.
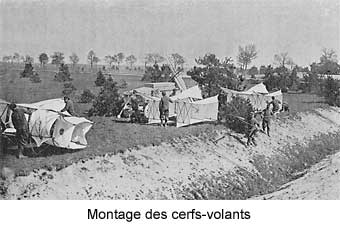 Voici maintenant la description des conditions
d’observation en cerf-volant pendant la guerre : Maurice
Arondel Voici maintenant la description des conditions
d’observation en cerf-volant pendant la guerre : Maurice
Arondel
« En 1915, dans l’Artois, j’ai fait un certain
nombre d’ascensions en cerf-volant, la marotte du commandant
Saconney, je crois même détenir le record d’altitude
avec cet engin : 3 heures à 600 mètres. Il était
difficile d’obtenir des résultats précis
avec un tel appareil à cause des changements d’altitude
fréquents au cours d’une même observation
».
Marc Brillaud de Laujardiere
« J’ai eu l’occasion, lors des attaques du
9 mai 1915, en Artois, d’ascensionner dans un de ces engins
, jusqu’à 600 mètres d’altitude, mais
l’irrégularité du vent était telle
qu’il fallait sans cesse agir sur les câbles pour
y remédier, ces manœuvres rendaient l’observation
presque impossible, en tout cas d’une efficacité
à peu près nulle. »
Guillotin
« Il est facile d’imaginer l’ampleur des
mouvements de la nacelle quand le train de cerfs-volants perdait
ou augmentait d’altitude par l’irrégularité
du vent. Par vent régulier, le train figurait un i
dans le ciel et l’observation à la jumelle était
facile, mais personnellement je n’ai éprouvé
cette facilité que très rarement. »
J. Mathieu
« La visibilité étant très bonne,
un ciel bien ensoleillé, sans aucun nuage, ma vue s’étendait
à plus de 50 km. La nacelle était parfaitement
stable, sans aucun mouvement. J’avais l’impression
d’avoir été cloué dans le ciel.
C’était merveilleux. »
|





