| Ballons
et dirigeables (1899-1917)
Les archives militaires sont généreuses et précises
quant à la succession des activités de Saconney.
Cependant. Un récit chronologique est difficile à
conduire parce que les missions étaient abandonnées
puis reprises. Pour éviter ces discontinuités,
les travaux de Saconney décrits ci-dessous sont relatés
par thème en s’étendant davantage sur
le cerf-volant et ses fonctions.
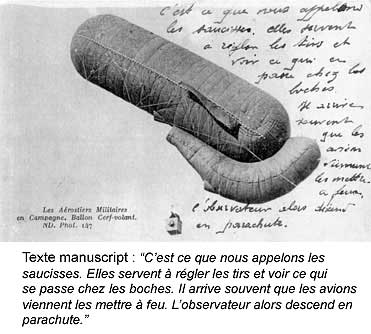 En
1899, le ciel est à peu près vide d’hommes.
L’unique moyen pour voyager dans l’atmosphère
est le ballon qui a besoin soit d’hydrogène,
soit de gaz d’éclairage. Les deux gaz sont préparés
dans des installations complexes (l’ expression «
usine à gaz » pour désigner un dispositif
complexe est demeurée) et cotîteuses donc réservées
aux institutions ou aux individus fortunés, c’est-à-dire
les militaires, les grands bourgeois et les aristocrates aisés.
Quelques bateleurs organisent également des spectacles
à partir de ballons. Les personnes les plus clairvoyantes,
et Saconney en faisait partie, devinaient que l’avenir
appartenait aux avions mais dans un délai indéfinissable.
Pour les civils, le voyage en ballon était une aventure
sportive et mondaine. Pour les militaires, traumatisés
par le siège de Paris en 1870, le ballon est le seul
moyen pour observer les environs d’une place encerclée
ou pour la quitter et communiquer avec l’extérieur. En
1899, le ciel est à peu près vide d’hommes.
L’unique moyen pour voyager dans l’atmosphère
est le ballon qui a besoin soit d’hydrogène,
soit de gaz d’éclairage. Les deux gaz sont préparés
dans des installations complexes (l’ expression «
usine à gaz » pour désigner un dispositif
complexe est demeurée) et cotîteuses donc réservées
aux institutions ou aux individus fortunés, c’est-à-dire
les militaires, les grands bourgeois et les aristocrates aisés.
Quelques bateleurs organisent également des spectacles
à partir de ballons. Les personnes les plus clairvoyantes,
et Saconney en faisait partie, devinaient que l’avenir
appartenait aux avions mais dans un délai indéfinissable.
Pour les civils, le voyage en ballon était une aventure
sportive et mondaine. Pour les militaires, traumatisés
par le siège de Paris en 1870, le ballon est le seul
moyen pour observer les environs d’une place encerclée
ou pour la quitter et communiquer avec l’extérieur.
À la suite de ses ascensions en ballon à Grenoble,
Saconney passe le Brevet Supérieur d’Aéronaute
le 22 mai 1902. (Bizarrement, il ne passera celui d’
observateur en ballon qu’une fois la guerre terminée,
en novembre 1920). Toujours en 1902, lors des manœuvres
de forteresse au Camp de Chalon. Saconney se distingue par
la rapidité et la sûreté des informations
qu’il fournit du haut de son ballon. Il devient spécialiste
aérostier et c’est l’une de ses grandes
occupations jusqu’au début de la guerre.
Il participe en 1903 à la rédaction du règlement
sur la construction du matériel d’aérostation,
est nommé au Bataillon d’aérostiers de
Versailles puis, en 1906, au Service de l’Aérostation
à Paris.
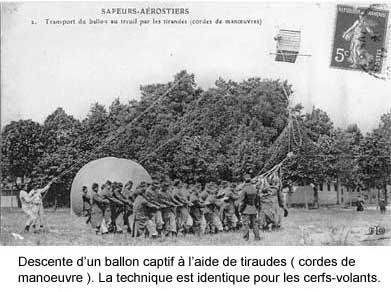 En
août 1914, Saconney constitue une compagnie d’aérostiers
et c’est lui seul qui organise la nouvelle fonction
des ballons captifs qui est de suivre partout l’artillerie
en campagne et de régler les tirs. Il a vu que les
progrès de l’artillerie ont rendu caduques les
forteresses et imposent à toutes les armes la guerre
en rase campagne. En
août 1914, Saconney constitue une compagnie d’aérostiers
et c’est lui seul qui organise la nouvelle fonction
des ballons captifs qui est de suivre partout l’artillerie
en campagne et de régler les tirs. Il a vu que les
progrès de l’artillerie ont rendu caduques les
forteresses et imposent à toutes les armes la guerre
en rase campagne.
Les Français utilisent d’abord
le ballon sphérique, puis rapidement le ballon cerf-volant
(dit saucisse en argot militaire) copié sur le ballon
allemand (Drachen). L’idée d’un croisement
ballon et cerf-volant est due à l’anglais Edmund
Archibald en 1885. Au début de la guerre, Albert Caquot
améliore le système allemand. Saconney ayant
découvert la nouvelle fonction tactique des ballons
captifs va également créer les écoles
où seront fonnés les observateurs. Le rôle
des ballons est capital et les moyens qui leur sont consacrés
en donne une idée. Selon J. Branche, les 75 compagnies
disposaient chacune de 130 hommes sur le front et environ
35 militaires à l’arrière, soit un total
de 165 militaires par compagnie auxquels il faut ajouter autant
de civils (fabrication de treuils, camions, gaz). Ce sont
donc 25.000 hommes (et femmes) environ qui ont constitué
l’aérostation et les 4.170 ballons (dont 2.538
de barrage contre avion) de la guerre de 14. À titre
indicatif, il y avait lors de la bataille de la Somme un ballon
tous les 700 ou 800 mètres.
Au cours de la guerre, Saconney est successivement
commandant de section, puis de compagnie, de groupe des compagnies,
inspecteur de compagnie, commandant d’aérostation
d’armée et finalement inspecteur des Compagnies
d’aérostiers. Il abandonne l’aérostation
pour la D.C.A. en 1917.
Le rôle essentiel de l’aérostation
pendant la guerre a été très largement
sous-estimé. Il est masqué par la gloire envahissante
de l’aviation, surtout la chasse, dont les succès
amplement claironnés consolaient des malheurs de la
guerre. On a plus écrit sur le seul « chevalier
Guynemer » que sur les 10.000 aérostiers du front.
|





