| L’aérologie
et les cerfs-volants (1912 – 1914 )
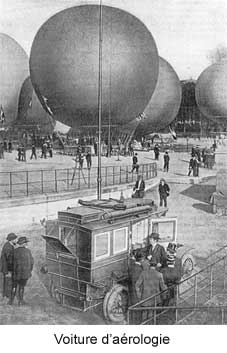 C’est
une tempête dévastatrice en mer Noire en 1854
qui convainc que seule une vision continentale ou planétaire
permettra de prévoir le temps. Des recherches dispersées
avaient bien été entreprises auparavant, mais
cette tempête conduit à unifier puis à
rationaliser et donc quantifier les phénomènes
atmosphériques. Pour cela, il faut sonder l’atmosphère
avec des appareils de mesure. Ces travaux se sont considérablement
développés pendant la jeunesse de Saconney. C’est
une tempête dévastatrice en mer Noire en 1854
qui convainc que seule une vision continentale ou planétaire
permettra de prévoir le temps. Des recherches dispersées
avaient bien été entreprises auparavant, mais
cette tempête conduit à unifier puis à
rationaliser et donc quantifier les phénomènes
atmosphériques. Pour cela, il faut sonder l’atmosphère
avec des appareils de mesure. Ces travaux se sont considérablement
développés pendant la jeunesse de Saconney.
Les aérostiers, au moins autant que
les marins, ont un besoin vital de savoir le temps à
venir. Dès les débuts de sa carrière,
Saconney a été confronté au vent par
les ballons puis les cerfs-volants. C’est avec ces mêmes
appareils qu’il va mesurer l’atmosphère.
La fonction de chef de laboratoire d’aérologie
et de téléphotographie lui est attribuée
le 9 octobre 1912. La prise en charge de l’aérologie
par les militaires est certainement due en partie aux insuffisances
des services officiels civils équivalents à
la même époque.
Fin décembre 1912, Saconney est installé
avec une dizaine d’hommes dans les casemates délabrées
du Fort d’Issy près de Paris.
Autant que de prévisions pour le lendemain,
les aviateurs et aéronautes désirent savoir
la direction et la vitesse du vent dans les quelques centaines
ou milliers de mètres qu’ils vont traverser dans
l’heure suivante et à l’endroit parfois
isolé où ils vont voler. Les avions de 1912
volent à environ 100 km/h, c’est-à-dire
moins vite que la moindre des automobiles actuelles et par
conséquent un vent contraire réduisait leur
vitesse à quelques dizaines de km/h.
Saconney conçoit donc le matériel
aérologique suivant entièrement contenu dans un
véhicule aménagé. Il contient :
un mât anémométrique gigogne de 25 mètres
de hauteur
de petits ballons captifs de 70 cm de diamètre retenus
jusqu’à 1000 m d’altitude. Ces ballons indiquent
( par l’inclinaison et la traction du fil de retenue)
la direction et la vitesse du vent lorsque ce dernier est faible.
de petits ballons pilotes libres dont on suit la trajectoire
au théodolite les jours de vent moyen (inférieur
à 15 m/s). Ils permettent de mesurer la vitesse et la
direction du vent à toutes les altitudes.
des cerfs-volants les jours de vent moyen et surtout de vent
fort
Saconney utilise, soit ses propres cerfs-volants, soit ceux
de son ami Marc Pujo selon la vitesse du vent. Dans les deux
cas, ce sont des cerfs-volants de 4 à 5 m2. Ils sont
attachés par une cordelette d’acier de 2000 à
3000 mètres et leur traction mesurée au dynamomètre
permet de calculer la vitesse du vent jusqu’à 2500
mètres d’altitude. Un enregistreur placé
au sol permet de mesurer les variations de vitesse à
une altitude donnée.. Le cerf-volant est alors en effet
le seul appareil permettant d’estimer la vitesse des rafales
qui sont un péril majeur pour les avions. Saconney pense
ainsi pouvoir observer les « régions de remous
et les changements brusques de direction du vent « .
« Perce-brume ». Saconney invente cet appareil pour
mesurer la hauteur et l’épaisseur de la couche
nuageuse. C’est un dispositif équipé d’une
minuterie qui dégage de minute en minute un papier photographique
. L’appareil est élevé en cerf-volant (ou
en ballon captif) en alternant ascensions et arrêts de
façon à ce que la pellicule soit impressionnée
lors des paliers. Au retour du perce-brume, le développement
indique l’exposition à la lumière vive du
jour ou terne de la brume et permet de déterminer la
hauteur des nuages.
 Des mesures sur le câble métallique du cerf-volant
permettent de mesurer la charge électrique des nuages
et selon Saconney de savoir s’il s’agit de nuages
d’orage. Cette mesure peut se faire sans vent. Il suffit
de dérouler au sol 1500 m de câble et de l’enrouler
au treuil à 15 m/s. En quelques dizaines de seconde,
le cerf-volant s’élève ainsi à 1000
m d’altitude.
La voiture d’aérologie contient également
un bureau de dessinateur, un atelier, un treuil avec 4000 m
de câble d’acier, les appareils classiques de météorologie
(baromètre, hygromètre, thermomètre, anémomètre,
néphoscope pour mesurer la vitesse des nuages) et –
merveilles finales – la T.S.F. et « un éclairage
électrique intense » ;
Des mesures sur le câble métallique du cerf-volant
permettent de mesurer la charge électrique des nuages
et selon Saconney de savoir s’il s’agit de nuages
d’orage. Cette mesure peut se faire sans vent. Il suffit
de dérouler au sol 1500 m de câble et de l’enrouler
au treuil à 15 m/s. En quelques dizaines de seconde,
le cerf-volant s’élève ainsi à 1000
m d’altitude.
La voiture d’aérologie contient également
un bureau de dessinateur, un atelier, un treuil avec 4000 m
de câble d’acier, les appareils classiques de météorologie
(baromètre, hygromètre, thermomètre, anémomètre,
néphoscope pour mesurer la vitesse des nuages) et –
merveilles finales – la T.S.F. et « un éclairage
électrique intense » ;
Aux manœuvres de l’été 1913 qui consacrent
la valeur de l’aviation militaire , la station météorologique
mobile de Saconney fournit en 30 minutes la description de l’atmosphère
jusqu’à 3000 m et elle est exposée à
Paris au 5e salon aéronautique la même année.
Pendant la guerre de 14 – 18, la météorologie
occupera plusieurs milliers d’hommes et aura un rôle
déterminant (usage des gaz de combat et réglage
des tirs d’artillerie). Saconney bien qu’ayant
été parmi les précurseurs de la météorologie
militaire la délaissera pendant le conflit.
Au retour de la paix, le renouveau de l’Organisation
Météorologique Internationale s’organise.
C’est dans ce cadre qu’en 1919 le commandant Saconney
est président de la commission d’application
de la météorologie à la navigation aérienne.
Il se trouve là parmi les plus éminents spécialistes
mondiaux de la météorologie.
|





