|
Aérostier
dans la guerre
 Le gouvernement de cette belle époque désirait
avoir une armée équivalente à celle de
l’Allemagne. Les populations respectives étaient
de 39 et 66 millions. Il fallait donc un service militaire plus
long en France afin de compenser la faible population. Il était
de trois ans.
Le gouvernement de cette belle époque désirait
avoir une armée équivalente à celle de
l’Allemagne. Les populations respectives étaient
de 39 et 66 millions. Il fallait donc un service militaire plus
long en France afin de compenser la faible population. Il était
de trois ans.
Pour adoucir cette longue durée, les militaires qui effectuent
des vols en aéroplane, dirigeable ou cerf-volant se voient
attribuer des primes ou bonifications. Ainsi les soldats effectuant
quatre ascensions en cerf-volant d’une durée de
30 minutes chacune au minimum et à plus de 100 mètres
de hauteur au cours des manœuvres de 1913 ont droit à
une bonification de trois mois (Journal Officiel du 7/11/1913).
La compensation par trois mois de liberté de deux heures
passées en l’air donne à penser que les
autorités militaires considéraient le vol en cerf-volant
comme une variante aérienne de la roulette russe.
Picavet est incorporé le 10 octobre 1913 à la
fin de ses études et ne sera libéré que
le 21 juillet 1919. C’est-à-dire qu’il passe
environ 6 ans, de 21 à 27 ans, dans l’armée.
Picavet est affecté initialement dans l’aviation,
mais rapidement il est muté dans l’aérostation
(dont dépendent les cerfs-volants militaires) à
Saint-Cyr , puis Versailles près de Paris. Le maître
des lieux est le capitaine Saconnay qui récupère
autant qu’il le peut les membres les plus actifs des quelques
25 sociétés cerfs-volistes pour faire fonctionner
la section automobile de cerfs-volants montés. Leur travail
consiste à régler les problèmes mécaniques
de moteur ou de treuil ou à effectuer des travaux de
corderie. Picavet passe donc son temps entre l’huile des
moteurs et les nœuds.
Au printemps, le groupe part vers les « frontières
de l’est » pour des manœuvres. Le cortège
de véhicules comprend une voiture d’aérologie
(météo), une voiture avec remorque pour le matériel
de photo aérienne et enfin la voiture avec remorque pour
les cerfs-volants. La vitesse est d’environ 25 km/h. Arrivée
aux environs de Toul, l’équipe s’installe
dans un hangar à dirigeable. C’est au-dessus de
VILLIERS-LE-SEC que le sapeur TOURTAY, photographe de la section,
est élevé par des cerfs-volants à 650 m
d’altitude pendant 1 h 25.
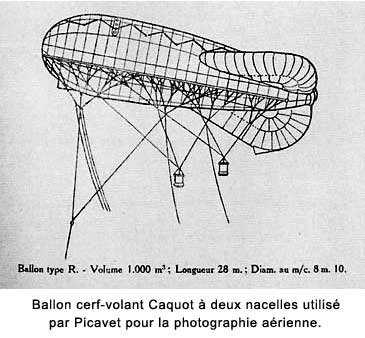 Au
cours de la même période, Picavet fait également
plusieurs ascensions en cerf-volant. Au
cours de la même période, Picavet fait également
plusieurs ascensions en cerf-volant.
Pendant la guerre elle-même, commencée en août
1914, Picavet est resté dans l’aérostation.
En août 1915 il est sergent-chef de section de cerf-volant
à la 30e Compagnie d’Aérostier.
En mai 1916, il est sous-lieutenant de compagnie avec fonction
d’officier de manœuvre. A ce titre, il réussit
le 5 mai 1916 à ramener au sol le ballon cerf-volant
(ou saucisse) et son observateur avant que n’arrive la
bourrasque qui casse les câbles de 24 ballons. 28 observateurs
sont emportés et 5 tués. Certains de ces ballons
avaient deux nacelles et deux observateurs. La photo ci-jointe
montre Picavet pris en photo de la deuxième nacelle d’un
ballon de ce type.
Au cours de la guerre, Picavet est successivement dans la 30ième,
47ième, 48ième et 49ième compagnie d’aérostiers.
Il est commandant de cette dernière. Il est également
temporairement instructeur aux écoles d’aérostation
de VADENAY et d’ORIGNY.
Retour à la vie civile
Picavet se marie peu avant la fin de la guerre et a deux filles
en 1919 et 1921. Il n’apparaît pas qu’il se
soit encore intéressé au cerf-volant.
La carrière professionnelle de Picavet commence à
Paris, puis il devient directeur d’une usine à
SUCY-en-BRIE. De 1928 à 1957, il est ingénieur
en chef d’une filature à TOURCOING.
Durant la deuxième guerre mondiale, Picavet est commandant
du parc de la base aérienne de BOURRASSOL (près
de Toulouse) de juin 1941 à janvier 1943. Parallèlement
à ces activités, il s’occupe très
activement d’une société de tir, sport dans
lequel il fut un champion.
Pierre Picavet est décédé à Tourcoing
le 21 juillet 1973.
Remerciements
- A Madame COUILLET pour m’avoir très gentiment
donné des renseignements sur son père et les photos
qui illustrent cet article.
- au Service Historique de l’Armée de l’Air
à Vincennes
- à Monsieur ZAMPAOLO pour une aide décisive.
 |
|
|
|
|
|





