| Mathieu
DUTIHL et son cerf-volant
 De
Romas a confié la construction du cerf-volant en juillet
1752 à « plusieurs Messieurs non moins intelligents
qu'adroits». C'est une définition satisfaisante
des cerfs-volistes. Il s'agissait des frères Dutihl,
Jacques et particulièrement Mathieu, gentilshommes
périgourdins. De
Romas a confié la construction du cerf-volant en juillet
1752 à « plusieurs Messieurs non moins intelligents
qu'adroits». C'est une définition satisfaisante
des cerfs-volistes. Il s'agissait des frères Dutihl,
Jacques et particulièrement Mathieu, gentilshommes
périgourdins.
Figuier dans "Les merveilles de la science" donnait
la biographie suivante de notre cerf-voliste:
"Mathieu Dutilh, seigneur et baron de la Tuque, né
à Nérac en 1715, était, à 25 ans,
avocat au parlement de Bordeaux. Ses relations avec Romas
commencèrent en 1740 et continuèrent, sans interruption,
jusqu'à la mort de ce dernier.
Ces deux personnages travaillèrent avec la même
ardeur aux belles expériences de physique que nous
avons à raconter. C'est au château de la Tuque,
qui appartenait à Mathieu Dutilh, qu'eut lieu le 14
mai 1753, la première expérience sur l'électricité
atmosphérique. Les frères Dutilh et Romas assistaient
seuls à cette expérience, qui fut répétée
publiquement, le 7 juin de la même année, sur
les allées qui entourent la ville de Nérac.
En 1760, Mathieu Dutilh fut appelé au gouvernement
du duché d'Albret et du comté de Bas-Armagnac,
avec le titre d'intendant général et commissaire
député de S.A.S Godefroy de Bouillon, duc souverain
de l'Albret. Il mourut aveugle en 1791.
Ses travaux sur le droit coutumier des provinces du midi de
la France, lui avaient acquis une grande célébrité.
Aussi ses collègues du parlement de Bordeaux, le désignaient-ils
sous ce titre: l'aveugle clairvoyant."
Histoire d'un cerf-volant
Mathieu n'a pas inventé la forme du cerf-volant, il
a adapté un jouet à sa nouvelle fonction scientifique.
Il y avait alors peu de formes possibles. Tous les cerfs-volants
étaient plans, sans dièdre et à queue.
Vraisemblablement les formes les plus courantes étaient
constituées d'un longeron vertical et d'une double
vergue en forme d'ellipse (cerf-volant cœur) ou d'une
vergue en forme de demi~cercle (cerf-volant poire) ou finalement
d'un simple bâton droit (cerf-volant diamant). Ce dernier
cerf-volant est celui de Franklin lorsque la vergue a la même
longueur que le longeron.
Les formes seraient (c'est une hypothèse)
parues dans cet ordre et avec une construction de plus en
plus simple. La disparition s'est faite naturellement dans
le même ordre. Il ne reste aujourd'hui que le dernier
né, le cerf-volant diamant.
Le cerf-volant des frères Dutihl, appelé
parfois cœur, conserve encore vaguement la forme animale
qu'avaient ses ancêtres orientaux. Il lui en reste au
début du XXe siècle les désignations
suivantes:
- la tête pour le triangle supérieur - les oreilles
pour les pompons latéraux - l'épine pour le
longeron, - la queue que nous désignons encore de ce
nom.
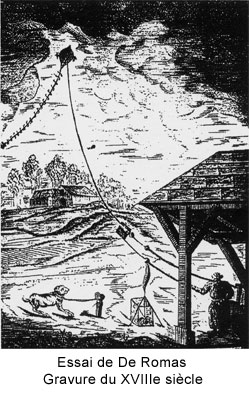 L'étymologie
du mot cerf-volant proviendrait d'ailleurs de l'altération
de l'expression serpent-volant (dictionnaire historique de
la langue française Robert 1992). D'autres langues
continuent à appeler le cerf-volant « dragon
». L'étymologie
du mot cerf-volant proviendrait d'ailleurs de l'altération
de l'expression serpent-volant (dictionnaire historique de
la langue française Robert 1992). D'autres langues
continuent à appeler le cerf-volant « dragon
».
Le cerf-volant de Dutihl, banal au XVIIIe
siècle, est disparu avant 1914 et a fait quelques très
rares réapparitions jusque vers 1960. On ne le voit
plus jamais de nos jours.
Certainement le cerf-volant était très
peu pratiqué du temps de Louis XV en France. Le pays
était peu peuplé et par une population misérable
dont même la survie était incertaine. La même
année, 1753, que celle des essais de de Romas, le marquis
d'Argenson relate que 800 personnes meurent de faim et de
froid en un mois d'hiver dans le seul faubourg Saint-Antoine
à Paris. Dans cette population couramment affamée,
une pelote de ficelle et du papier étaient des articles
de luxe. La rareté du cerf-volant est attestée
par l'apparition très tardive du mot pour le désigner
(1669 selon le Robert). Autrement dit, il est douteux que
le grand-père des Dutihl ait disposé d'un mot
pour désigner le cerf-volant, à supposer qu'il
l'ait connu.
|





